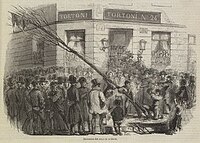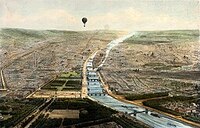Valin, Lucien
Lucien Valin est né à Rouen le 12 septembre 1867. Il est le fils d’Élysée Valin, agréé au Tribunal de commerce, et de Julie Letellier, sans profession. Il fait ses études au lycée Corneille puis à la faculté de droit de Paris. Il épouse le 11 décembre 1880 Marie Céline Collas à Paris. Il exerce la profession d'avoué à la Cour d'appel de Rouen à partir de 1895, et est président des Avoués des cours d'appel de province. Son cabinet se trouvait rue de Fontenelle.
En 1897, il est membre du Photo-club rouennais. En 1902, il est président du Stade rouennais et du comité régional de l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques et membre des Amis des monuments rouennais. Il est élu conseiller municipal de Rouen en mai 1902.
Érudit passionné par l'histoire de sa ville, il devint membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen en 1910.
En 1911, lors des fêtes du millénaire normand où il préside le comité du congrès, il est fait officier de l'ordre de Saint-Olaf.
Il est élu maire de Rouen le 16 juillet 1914. Il est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale au 43e régiment d'artillerie en tant que capitaine de réserve commandant une section de munitions d'infanterie. Il est cité à l'ordre de l'armée le 4 août 1918 du fait des opérations périlleuses menées du 18 au 30 juillet 1918 à la tête de sa section.
Il reçoit la croix de guerre 1914-1918 et est nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire.
Il exercera la fonction de maire du 4 janvier 1919 au 21 avril 1922, date à laquelle, gravement malade, il doit démissionner. On lui doit entre autres la fondation du musée Le Secq des Tournelles, consacré à la ferronnerie, ainsi que le transfert de la bibliothèque municipale des archives anciennes à l'hôtel de ville.
Il demeurait 21 rue de l'École, à Rouen.
Il meurt à Rouen où il était soigné. Ses obsèques sont célébrées dans l'église Saint-Vincent de Rouen et il est inhumé dans le caveau familial au cimetière monumental de Rouen.
Médecins
/educ = EDUCATION, MEDICAL or its specifics; Manual 35.2.3; in biographies: Manual 32.16.7; when not to use: Manual 34.11.1; "role of physician in ..." = PHYSICIAN'S ROLE: see note there
Une administration municipale "orageuse" à Caen à la fin de l'Ancien Régime
Administration communale -- France -- Caen (Calvados) -- 18e siècle
Yver, Jean
Professeur de droit et de sciences politiques
Le Picard, René
Chanoine de Rouen, docteur ès Droits canonique et civil. Ordonné prêtre en 1904, il est le fondateur de l'association philanthropique du Val d'Aubette (1929-1983)
Cours de code civil (1850)
Droit civil -- France -- Manuels d'enseignement
Cours de code civil (1847)
Droit civil -- France -- Manuels d'enseignement
Mariage -- Droit -- France -- Manuels d'enseignement
Séparation de corps -- France -- Manuels d'enseignement
Cours de code civil (1846)
Droit civil -- France -- Manuels d'enseignement
Mariage -- Droit -- Manuels d'enseignement -- France
Séparation de corps -- France -- Manuels d'enseignement
Demolombe, Charles
Jean-Charles Demolombe passa donc son enfance à Villers-Cotterêts, puis, pour suivre la tradition familiale, partit à Paris étudier le Droit. Ses professeurs furent entre autres les « Trois D » : Duranton, Ducauroy et De Mante. Reçu docteur en Droit le 2 août 1826, il s'inscrivit aussitôt à Paris à un concours de professeur de Droit suppléant, qui durait quatre mois et comportait quarante-cinq épreuves. Il le remporta, et fut alors nommé professeur suppléant à la faculté de Caen, reprenant alors la chaire du Professeur Cyril Athanase Grimaldi.
Charles Demolombe devint par la suite avocat consultant et professeur à l'université de Caen. Occupé par l'étude du Code, il décline toute autre activité telle que le poste de procureur à la Cour de cassation, un poste de professeur à Paris. Il est doyen de la faculté de Droit et bâtonnier de l'ordre des avocats. Il publie une œuvre monumentale qui est son Cours de Code civil de Napoléon en 31 volumes en 1845 et 1876. Cette œuvre, restée inachevée, s'arrêtant à l'article 1386, fut continuée par son successeur à l'Université de Caen, Louis Guillouard.
Il est toutefois élu le 23 janvier 1864 à l’Académie des sciences morales et politiques en section de législation à la place 5 à laquelle siégeait John Austin (1790-1859).
Il estime, comme la plupart de ses collègues civilistes du XIXe siècle, que l'objet de travail de juriste est le droit positif, qu'il réduit toutefois, comme ses collègues, au seul Code civil, sans égard pour la jurisprudence. Il dit : « Le droit est la loi civilement obligatoire ». Le droit vient de la loi et c'est l'autorité qui en a reçu la compétence par la Constitution qui fait la loi. C'est-à-dire le pouvoir législatif.
Il estime qu'il y a des principes qui viennent du droit naturel et d'autres qui viennent de la loi positive. Sans nier le droit naturel, il estime qu'il y a un droit naturel variable dans le temps et dans l'espace. Pour Demolombe, le droit naturel est contenu dans le droit positif, qui lui-même est contenu dans le Code civil.
Il diffuse ses idées non seulement par ses écrits, mais également par ses enseignements qu'il prodigue avec passion. Il est d'ailleurs l'un des premiers professeur à mener une véritable réflexion sur la méthode d'enseignement, n'hésitant pas à s'inspirer d'autres disciplines. Il recourt ainsi aux tableaux, schémas et figures pour illustrer ses raisonnements et transmettre ses idées. Il est ainsi, d'une certaine façon, le père du legal design.
La Fère
La Fère est une commune française située dans le département de l'Aisne en région Hauts-de-France.
Ancien siège de l'École royale d'artillerie de La Fère, elle est connue pour abriter la statue de l'Artilleur qui ornait auparavant le pont de l'Alma de Paris.
Pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), La Fère est envahie le 19 mai 1940 et la caserne sert de camp provisoire aux prisonniers faits par les Allemands (« Front StaLag 191 »). La ville est alors en zone occupée, en « France allemande » comme disent les anciens Laférois. La ligne de démarcation était représentée par le canal de la Sambre à l'Oise, et comme il n'y avait qu'un seul lycée, celui de La Fère, les jeunes de Chauny, Tergnier… devaient disposer d'un laissez-passer pour venir y étudier. Tous les commerçants devaient présenter un ausweis (carte d'identité) ou passierschein (laissez-passer) pour aller, par exemple, chercher leurs marchandises.
Le 3 septembre 1944, la 28e division d'infanterie américaine, basée à Charmes, qui a subi de lourdes pertes durant les combats, libère La Fère.
Au cours de ces deux guerres mondiales, La Fère dut faire face aux nombreuses destructions de son patrimoine.