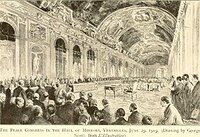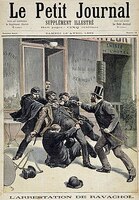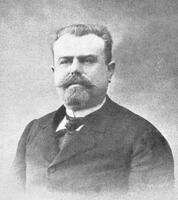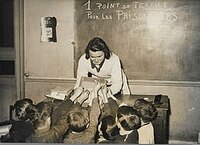Demolins, Edmond
Edmond Demolins, né le 23 janvier 1852 à Marseille et mort le 27 juillet 1907 à Caen, est un économiste, sociologue et pédagogue français social, contre-révolutionnaire et corporatiste. Il est également connu pour avoir été le fondateur de l'École des Roches.
Disciple de Le Play, il fonde la revue La Science sociale, avec le soutien d'un autre disciple leplaysien Henri de Tourville (1842-1903). En 1897, il fait un voyage en Angleterre, où il rencontre le pasteur Cecil Reddie, fondateur de l'école d'Abbotsholme et de l'école de Bedales, où les cours sont remplacés par des activités artistiques, scientifiques et techniques dans lesquelles les enfants découvrent les savoirs nécessaires à leur instruction.
De retour en France, Demolins publie A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons. Cet ouvrage il fait l'éloge de la pédagogie active comme moyen de développement personnel, économique et social. Il fonde en 1899 l'École des Roches, pionnière dans le domaine des méthodes actives, alors que l'introduction de celles-ci — revendiquée tant par les disciples de Le Play, par les « républicains » ou par les « anarcho-syndicalistes » — acquiert « une dimension ambiguë tant sur le plan politique qu'idéologique ».
Profondément investi dans le combat des idées, ses réflexions s'adressent aux élus et aux électeurs : « Comment expliquer le respect, le fétichisme que les divers partis professent en paroles à l'égard du suffrage universel et la façon absolument indigne, méprisante, dont ils le traitent tous ? […] L'impossibilité de gouverner en pratiquant loyalement le suffrage universel tient à ce que la très grande majorité des électeurs est absolument incapable de connaitre et d'apprécier les questions qu'on lui demande de résoudre. […] J'ai sous les yeux le recueil des programmes, professions de foi et engagements électoraux de 1886. […] Vous ne pouvez rien imaginer de pareil […] En fait de vues politiques, on ne rencontre que des lieux communs, des déclamations, des projets de refonte complète de la Société des abstractions creuses : Jamais rien de pratique, de positif, rien qui donne l'idée de gens sérieux parlant à des gens sérieux d'affaires sérieuses. […] Les politiciens vivent du suffrage universel comme d'une industrie lucrative; il est leur bien, il est leur chose, il est leur moyen d'existence. Ce sont eux qui l'ont acclimaté parmi nous sous sa forme actuelle. »
Dans Les Français d'aujourd'hui - Les types sociaux du Midi et du Centre, il cherche les raisons de la nature des types sociaux du Midi et du Centre dans leur mode de subsistance et le climat. Le propos antiméridionalisme, résumé par l'historienne Céline Piot, n'est guère flatteur : « victime d'une incurable inaptitude au travail, le Méridional est naturellement porté vers la politique, cette industrie rentable des peuples fainéants et non industrieux ».
Sociologues
Un sociologue ou une sociologue est une personne qui étudie les faits et les groupes sociaux en produisant un discours ou un écrit respectant une méthode scientifique. Les résultats produits par les sociologues sont publiés et discutés par leurs pairs.
En France, la plupart des sociologues sont des enseignants-chercheurs dans des universités ou font de la recherche. D'autres exercent dans l'enseignement secondaire, travaillent dans des ministères ou des établissements publics tels que l'INSEE, l'ARACT ou l'ADEME, ou encore dans des structures privées (instituts de sondages, cabinets d'expertise, etc.).
Philosophes
Un philosophe (du grec ancien φιλόσοφος / philósophos, en latin philosophus) est une personne qui pratique la philosophie.
Au sens classique, un philosophe est une personne qui vit selon un certain mode de vie en se concentrant sur la résolution de questions existentielles relatives à la condition humaine. Au sens moderne, un « philosophe » est un professionnel qui enseigne la philosophie. Il peut être chercheur ou également enseignant-chercheur.
Marseille
Marseille (en occitan provençal Marselha ou Marsiho) est une commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône, dont elle est la ville-préfecture. Elle est le chef-lieu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fondée vers 600 av. J.-C. par des marins et des marchands grecs originaires de Phocée (d'où son appellation de « cité phocéenne ») sous le nom de Μασσαλία / Massalía, Marseille est depuis l'Antiquité un important port de commerce et de passage. Elle connaît un essor commercial considérable pendant la période coloniale et plus particulièrement au cours du XIXe siècle, devenant une ville industrielle et négociante prospère.
Héritage de ce passé, le grand port maritime de Marseille (GPMM) et l'économie maritime constituent actuellement l'un des pôles majeurs de l'activité régionale et nationale, et Marseille reste le premier port français, le deuxième port méditerranéen et le cinquième port européen.
L'ouverture de Marseille sur la mer Méditerranée en fait depuis ses origines une des villes les plus cosmopolites de France, marquée par de nombreux échanges culturels et économiques avec l'Europe du Sud, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie. Elle est d'ailleurs souvent considérée, depuis le XVIIe siècle, comme la « Porte de l'Orient » sur le littoral méditerranéen français.
En 2022, Marseille est la deuxième ville la plus peuplée de France avec 877 215 habitants et la principale ville française du littoral méditerranéen et de Provence. S'étendant au nord jusqu'à Aix-en-Provence, son agglomération est la troisième unité urbaine de France, avec 1 635 154 habitants, derrière Paris et Lyon. Depuis le 1er janvier 2016, Marseille accueille le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la seconde plus peuplée de France avec 1 922 626 habitants. L'aire d'attraction de Marseille est classée en troisième position, après celles de Paris et de Lyon avec 1 900 957 habitants en 2022. Ces données font de la cité phocéenne, la plus grande ville de Provence, du Midi de la France et de la région linguistique et culturelle d'Occitanie.
L'Opinion publique et les partis politiques en France, entre l'Armistice et la paix
1919 d'après les dates de parution du périodique. - Edition spéciale de << la Paix des peuples
Tours
Tours (prononcé : /tuʁ/ Écouterⓘ) est une ville située dans l'Ouest de la France, sur les rives de la Loire et du Cher, dans le département d'Indre-et-Loire, dont elle est le chef-lieu, en région Centre-Val de Loire. La commune est le chef-lieu de la métropole Tours Val de Loire et constitutive, avec son intercommunalité, de l’une des 22 métropoles françaises officielles.
La commune, comptant 138 668 habitants en 2022, est au centre d'une unité urbaine de 367 484 habitants (en 2022)[1], elle-même pôle d'une aire d'attraction de 526 370 habitants[2]. Elle est la plus grande commune, la plus grande unité urbaine et la plus grande aire d’attraction de la région Centre-Val de Loire, ainsi que la 15e aire d’attraction de France[3]. Son intercommunalité est, quant à elle, peuplée de 299 019 habitants en 2022, ce qui en fait également la première de la région Centre-Val de Loire par sa population.
Ancienne Caesarodunum cité des Turones, capitale de la IIIe Lyonnaise avec un des plus grands amphithéâtres de l'empire romain, elle devient sanctuaire national avec saint Martin, Grégoire de Tours et Alcuin sous les Mérovingiens et les Carolingiens, et les Capétiens font de la monnaie locale la monnaie du royaume, la livre tournois. Capitale du comté de Tours qui deviendra la Touraine, le « jardin de France ». Première ville de l'industrie de la soie, voulue par Louis XI, capitale royale sous les Valois[6] avec ses châteaux de la Loire et ville d'art avec l'École de Tours. Capitale de loyauté pour Henri III et Henri IV pendant les guerres de Religion et ville de repli en juin 1940, ce qui lui vaudra d'être en partie détruite.
La ville blanche et bleue est ville d'art et d'histoire avec son quartier du Vieux-Tours, site patrimonial remarquable. La cité jardin concentre un patrimoine vert et un paysage urbain fortement influencé par son espace naturel. La ville historique que l'on surnomme Le Petit Paris et sa région par son histoire et sa culture, ont toujours été une terre de naissance ou d'accueil de nombreuses personnalités, de rencontres sportives internationales, ville universitaire avec plus de 30 000 étudiants en 2019. Ville culinaire avec ses spécialités les rillettes, les rillons, les vignobles tourangeaux, ses fromages AOC Sainte-Maure-de-Touraine et ses nougats.
Aire urbaine du Grand Ouest, la ville fait partie de l'espace métropolitain Val de Loire-Maine. Elle accueille le 1er employeur de la région, le CHRU et de nombreux établissements de direction de vaste échelle. Elle est ceinturée par son périphérique, au centre d'une étoile autoroutière à cinq branches avec les A10, A28 et A85. L'agglomération de Tours est reliée au réseau national par deux gares, à Tours et Saint-Pierre-des-Corps pour les relations TER et TGV. Toutes les régions de France sont accessibles par le train et l'aéroport Tours-Val de Loire est un aéroport régional important et avec quelques destinations internationales. Le journal régional La Nouvelle République qui a son siège à Tours et est diffusé dans la région Centre-Val de Loire et une partie de la Nouvelle-Aquitaine renforce sa position centrale.
Cestac Louis Édouard (1801-1868)
Louis-Édouard naît à Bayonne le 6 janvier 1801 au numéro 45 de la rue Mayou (aujourd'hui 57 rue d'Espagne). Son père, Dominique Cestac, ancien « chirurgien de la marine », est devenu chirurgien de la ville et des prisons. Sa mère, Jeanne Amitessarobe, est d'ascendance basque espagnole.
Il a une sœur aînée, Marianne, et une cadette, Élise (1811-1849) qui deviendra sa collaboratrice.
Vocation précoce, Louis-Édouard Cestac commence ses études à l'école Saint-Léon de Bayonne, où il côtoie Michel Garicoïts, puis au petit séminaire d'Aire-sur-Adour, devient séminariste à Bayonne et, enfin, au grand séminaire de Saint-Sulpice à Paris, avant d'être renvoyé dans le Sud-Ouest pour raisons de santé. Il est nommé au Petit Séminaire de Larressore. Tout en poursuivant sa formation ecclésiastique, il devient professeur. Il est ordonné diacre le 26 juin 1825 et prêtre le 17 décembre 1825, à l'âge de 24 ans.
Le 27 août 1831, l'abbé Cestac est nommé vicaire à la cathédrale de Bayonne, à l'âge de 30 ans.
La nomination à la cathédrale est le tournant de la vie de l'abbé, qui se voit confier « l'apostolat extérieur ». De son propre témoignage, le spectacle de la misère des orphelines des faubourgs l'émeut et le pousse à soulager ces enfants. Il fonde pour elles un foyer d'accueil dès 1836, dans une maison prêtée par la ville de Bayonne et dénommée Le Grand Paradis.
Dès l'année suivante, il se trouve engagé au service des jeunes femmes qui souhaitent quitter la prostitution. Pour elles, il achète le 24 novembre 1838, et à crédit, un domaine agricole situé à Anglet : le domaine Châteauneuf qu'il appellera Notre-Dame du Refuge. Avec quelques éducatrices bénévoles, il organise pour ces jeunes femmes, appelées à l'époque « pénitentes », un projet d'éducation fondé sur l'amour de Marie, la liberté et le travail.
Le 7 avril 1908, le Pape Pie X signe le décret d'introduction de la cause de l'abbé Cestac. Cette étape lui confère le titre de « serviteur de Dieu ».
Le 13 novembre 1976, le Pape Paul VI promulgue le décret d'héroïcité des vertus qui lui donne le titre de vénérable.
Le 13 juin 2014, le Pape François promulgue un décret lui attribuant un miracle. Cette reconnaissance permet la béatification.
Louis-Édouard Cestac est béatifié à la cathédrale de Bayonne le 31 mai 2015 par le cardinal Amato en présence de l'ordinaire du diocèse, Mgr Marc Aillet, et d'une dizaine d'autres évêques. Sa fête est fixée au 27 mars selon le Martyrologe romain.
Anglet
Anglet (prononcé [ɑ̃ɡlɛt]) est une commune française, située au bord de l'océan Atlantique, dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.
Bayonne
Bayonne, Baiona en basque et en gascon, est une commune française et l’une des deux sous-préfectures du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.
En 1023, Bayonne est la capitale du Labourd, et s'étend au XIIe siècle vers et au-delà de la Nive, alors qu'est construit le premier pont sur l'Adour. La ville, à la suite du mariage en 1152 d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt, comte d'Anjou et du Maine, duc de Normandie et futur roi d'Angleterre, prend une importance militaire et surtout commerciale, grâce aux échanges maritimes avec l'Angleterre. Elle est séparée de la vicomté du Labourd en 1177 par Richard Cœur de Lion. Ce dernier confirme ou instaure un certain nombre de droits ou de libertés à la cathédrale comme aux habitants. En 1451, la ville est prise par la Couronne de France, au terme de la guerre de Cent Ans. La perte des échanges avec les Anglais et l'ensablement du fleuve, puis le déplacement de celui-ci vers le nord, l'affaiblissent ; le quartier de Saint-Esprit se développe néanmoins, grâce à l'arrivée d'une population juive fuyant l'Inquisition espagnole. Bayonne doit à cette communauté sa notoriété dans le domaine du chocolat. Le cours de l'Adour est modifié en 1578 sous la direction de Louis de Foix, et le fleuve retrouvant son embouchure antérieure, redonne au port de Bayonne l’activité perdue pendant plus de cent ans. Au XVIIe siècle, la ville est fortifiée par Vauban. En 1814, Bayonne et ses environs sont le théâtre de combats entre les troupes napoléoniennes et la coalition hispano-anglo-portugaise emmenée par le duc de Wellington ; la ville subit alors son ultime siège.
En 1951 est découvert le gisement de gaz de Lacq dont le soufre fatal extrait et le pétrole associé sont expédiés depuis le port de Bayonne. Durant la seconde moitié du XXe siècle, de nombreux grands ensembles sont construits, formant de nouveaux quartiers en périphérie, et la ville s'étend jusqu'à constituer une conurbation avec Anglet et Biarritz ; cette agglomération devient le cœur d'une vaste aire urbaine basco-landaise.
Bayonne est, en 2016, une commune de plus de 50 000 habitants, la principale de l'aire urbaine de Bayonne où elle côtoie Anglet et Biarritz. Malgré ses influences métisses, elle est aujourd'hui reconnue comme la principale ville du Pays basque français. Important maillon de l'eurocité basque Bayonne - San Sebastián, elle joue le rôle de capitale commerciale et touristique du bassin de l'Adour (la capitale industrielle et administrative étant Pau). L'industrie moderne — métallurgie et produits chimiques — a pu s'y implanter, grâce aux possibilités d'approvisionnement et d’expéditions par mer de son port. Mais ce sont surtout les activités de services qui, aujourd’hui, représentent le plus grand gisement d’emplois. Bayonne est également une capitale culturelle, ville aux influences basques et gasconnes forte d’un riche passé historique. Son patrimoine réside dans son architecture, la diversité des collections de ses musées, mais aussi dans ses spécialités gastronomiques ou ses événements traditionnels comme les célèbres fêtes de Bayonne.
Mainage, Thomas-Lucien (1878-1931)
Dominicain.- Professeur d'histoire des religions à l'Institut catholique de Paris
Les Loisirs ouvriers
communication faite au Congrès de la Ligue de l'enseignement à Lille, le 16 juin 1928
Labbé, Edmond (1868-1944)
Né à Paris, au no 31 place de la Bourse, ses parents s'installent à Douai, où son père exerce la profession de chapelier. Il a fait ses études à l'École normale de Douai (1887) avant de sortir major de l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Nommé professeur de l'ENP de Vierzon, première école nationale d’enseignement primaire supérieur et d’enseignement professionnel préparatoire à l’apprentissage a été construite entre 1883 et 1887 sur les hauteurs de Vierzon et fut destinée à servir de modèle aux futures écoles nationales professionnelles (ENP). Rapidement nommé directeur de l'École nationale professionnelle d'Armentières en 1901, il pressent l'importance de l'enseignement technique et se consacre à son développement.
Plaque de rue à Strasbourg.
Dès 1908, à 40 ans, le voici inspecteur général de l'Enseignement technique. Il fonde alors à Tourcoing la première école technique. Son action se poursuit et se traduit le 25 juillet 1919 par le vote de la loi Astier, véritable charte de l'enseignement technique, puis en 1920, c'est la création d'un sous secrétariat d'État à l'enseignement technique. Premier directeur général de cet enseignement nouvellement structuré, par un vote du Parlement en 1927, il exercera son activité sous une douzaine de ministres différents.
Fait sans précédent, Edmond Labbé est nommé conseiller à vie du ministère de l’Éducation nationale. Son œuvre ne s'arrête pas là et, en 1934, après quelques années de retraite, il est rappelé pour la lourde mission du commissariat général de l'Exposition internationale des arts et techniques (1937-1938). Retiré à Yvetot, c'est le 14 juillet 1944 qu'Edmond Labbé meurt, quelques mois seulement après son épouse Valentine Labbé.
Duval-Arnould, Louis
Louis Frédéric Eugène Duval est né le 6 août 1863, dans le 6e arrondissement de Paris. Il est le fils de Louis Isidore Duval (1821-1895), notaire puis gérant de biens et receveur de rentes, et de Geneviève Hermine Sophie Fournier (1827-1914). Il a une sœur, Marie Duval, décédée en 1858 à l’âge de huit ans.
La famille Duval est originaire de Picardie. Louis Isidore Duval fut maire de Béthisy-Saint-Pierre. Son frère Eugène (1823-1897) fut pharmacien à Beauvais et sa sœur Adèle Marie Célinie (1832-1880) épousa Ambroise Lavaux (1815-1889), cultivateur aisé à la ferme de Courgain (au Pin).
Très tôt, Louis Duval entre comme élève au collège Stanislas en classe de huitième en octobre 1872, et y poursuit sa formation jusqu’en classe de philosophie et l’obtention de son baccalauréat en juillet 1882.
Il fait ses classes au 30e régiment d’artillerie d’Orléans en 1882, et continue jusqu’en 1914 une carrière d’officier de réserve.
Il est diplômé de l’École libre de sciences politiques. En 1888, il est docteur en droit. Sa thèse s'intitule Études sur quelques points de droit romain au Ve siècle, d’après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire. Essai sur la législation française du travail des enfants (apprentis et jeunes ouvriers), Paris : impr. de Moquet, 1888, 109-172 p (B.n.F. Tolbiac, 8-F-5965). Il écrit d’autres ouvrages juridiques, et collabore par la suite à la Jurisprudence générale de Dalloz.
Fénelon, Gibon
Publiciste. Secrétaire de la Société générale d'éducation et d'enseignement. Né à Bourges ; mort à Paris
Bourges
Bourges (prononcé : /buʁʒ/) est une commune française, préfecture du département du Cher.
Avec 64 238 habitants en 2022, il s'agit de la commune la plus peuplée du département et la troisième commune la plus peuplée de la région Centre-Val de Loire, après Tours et Orléans, et devant Blois, Châteauroux et Chartres.
Au centre d'une aire d'attraction de 173 219 habitants en 2022, l'aire d'attraction de Bourges est la 65e de France et la 3e de la région.
Elle est aussi la capitale historique du Berry, province de l'Ancien Régime correspondant approximativement aux départements actuels de l’Indre et du Cher.
Ses habitants sont appelés les Berruyers.